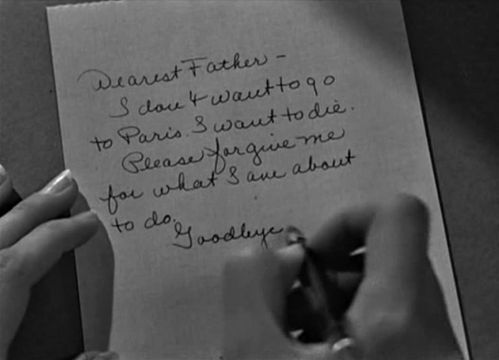« La foule vous est utile, jeunes beautés. Portez souvent vos pas errants hors de chez vous. C'est vers une troupe de brebis que va la louve pour trouver une proie à saisir ; c'est vers une compagnie d'oiseaux que se jette en volant l'oiseau de Jupiter. Une belle femme doit aussi se montrer en public : dans le nombre elle trouvera peut-être quelqu'un qu'elle séduira. Que dans tous les endroits, avide de plaire, elle passe quelque temps, et qu'elle s'applique de toute son attention à faire valoir sa beauté. (...) Marcher les cheveux épars et donner libre cours à ses larmes sied bien à une femme. »
Ovide, L'art d'aimer
Je sors timidement de chez moi et tous les regards, toutes les proximités, m’agressent l’air de rien, un type qui me frôle dans le métro, des paires d’yeux qui cernent machinalement leur environnement, tout devient source d’angoisse le temps que je reconstruise mon hermétisme calme, celui qui fait que l’on ne se souviendra jamais des milliers d’inconnus que l’on côtoie pourtant sincèrement le temps des trajets, des visages que l’on appréhende nettement sans trop avoir conscience qu’ils nous sortiront de l’esprit et dont l’éphémère pourrait nous sembler triste par un raccourci paresseux de l’esprit.
Ce qu’il peut y avoir d’angoissant dans le contact avec le passant : le fait de ne rien se devoir, ni bienveillance ni malveillance, chacun est livré à ses propres forces, abandonné à son sort, c’est l’étape qui précède toute politesse, avec la politesse on commence à avoir des obligations, ne serait-ce que la politesse du regard, considérer l’autre, ne pas le fixer, on pourrait avoir à répondre de son regard. Avant toute politesse il n’y a donc que ce rapport de force des hermétismes, il s’agit de glisser sur la présence des autres et d’être aussi glissant qu’eux, ne pas se fissurer de gêne, ne pas être malgré soi un centre d’intérêt ou d’inquisition ; l’angoisse est là, dans la crainte et l’incertitude, toujours un peu métaphysique.
Murielle prédit que je vais croiser C. et je passe la journée à le croire, cela renforce mon malaise mais je trouverais normal de le voir, j’en serais même assez contente, il y a quelques jours un rêve a suffi à chasser ce je ne sais quoi d’exaspération qu’il m’inspirait, de ces rêves bizarres qui modifient véritablement des situations réelles comme un état conscient et raisonnable pourrait le faire. J’étais déjà tombée amoureuse d’un homme politique dans un rêve, à mon réveil je désirais violemment lui écrire, durant toute la journée j’avais sincèrement pensé à lui. Impossible de relire ce que j’écrivais sur C. sans une furieuse envie de me frapper, l'impression d'avoir été vulnérable et imprudente, un peu infidèle aussi puisque je n'écrirais plus la même chose, l’exaspération n’est légitime que contre moi-même. Quelle est la valeur d’un sentiment, figé dans des écrits, qui ne correspond plus à l’actualité ? Quelque chose subsiste d’une analyse périmée, elle pourra être répétée dans de nouvelles circonstances, il est peu probable d’innover en parlant d’amour mais le sujet a soif de vécu, quand on vit les choses telles que maintes fois écrites, dites, filmées, il n’y a aucune impression de redite, on pense seulement comprendre véritablement et parfois à nouveau ce dont l’on ne connaissait que le nom, la surface. Reste aussi le goût puissant de l’instant, il faut reconnaître que ce qui est écrit a existé d’une existence violente et déraisonnable, insensible à un bon sens qui pourtant reviendra, j’ai souvenir de m’être intimé l’ordre de ne jamais regretter mon attitude quand je guettais C. à l’entrée de la fac ou quand je tremblais gentiment en lui offrant un livre à la fin de l’année, je me l’ordonnais par conscience que la justification évidente de mes actes passerait, que bientôt ils me sembleraient absurdes ou inappropriés, qu’ils perdraient en fait la base légitime de leur réalisation, mais que cette perte de matière ne devait jamais équivaloir à un démenti strict parce qu’ils sont de ces rares instants dont je peux dire qu’ils ont été très pleinement et consciemment vécus, en accord avec des exigences et des principes qui me semblent être, eux, définitivement ancrés en moi.
En allant emprunter des films à la bibliothèque près de la fac je m'arrête devant ses grilles et ses marches animées par les candidats aux rattrapages, cette structure étudiante et ce qu’elle représente de cours, d’amitié et de moments d’hiver est profondément chaleureuse, je ne peux rien désirer d’autre que ce qu’elle contient et même les déceptions qu’elle provoque, mauvais cours, mauvaises personnes, mauvaises journées, tout cela a la légèreté de circonstances particulières qui ne disent rien de profond. J’attends la rentrée aveuglément, je ne veux plus de ces vacances dont on nous abreuve jusqu’à écœurement et pourtant il n’y aura aucune satisfaction intense et concentrée lorsque les cours reprendront, chaque moment souffrira de son insuffisance laborieuse, une longue introduction aux cours, des conversations ni utiles ni agréables, il faudrait pouvoir tout synthétiser très rapidement pour redonner aux faits épars un vrai goût, mais à défaut d’avoir une telle capacité je garde en tête l’idée de la fac, des cours, de l’amitié, des moments d’hiver, je sais que c’est ainsi qu’ils se déclinent en moments, je m’éduque à poser un regard plus doux sur ces moments, au nom de ce qui les contient.
A défaut de croiser C. je rencontre JD dont les récits de vadrouilles passées me rappellent qu’il est plus âgé, qu’il a vécu des choses que je ne vivrai jamais et qu’il a un rapport à la vie fait d’immersions qui doivent abolir entre eux une certaine distance, je crois que c’est ainsi que l’on peut parvenir à être moins impitoyable avec les expériences, lorsque l’on s’est laissé happer par la cadence d’événements jusqu’à ne plus les interroger, jusqu’à les apprécier en vertu d’une acceptation qui m’est inconnue, acceptation d’un monde et de certaines bases instables. Dans la rue des filles qui passent incarnent la joie de vivre, la jeunesse façon film de Sophie Marceau, elles ont un mérite d’assaisonnement, elles montrent la possibilité d’un goût relevé d’une soi-disant insouciance, je comprends ce qu’il peut y avoir en elles d’émouvant, le constat d’un épanouissement dans un monde qu’elles n’ont pas choisi et qu’elles investissent pourtant comme si tout était normal, sans considération du néant ou crainte particulière, comme si l’engluement était le mode d’être normal, sain.